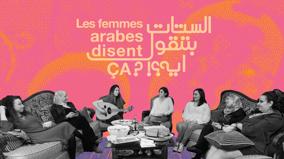Nouveauté – Suivez les fourmis…
Boat People
Avec l’aide du cinéaste d’animation Kjell Boersma, l’illustratrice et autrice d’origine vietnamienne Thao Lam propose une importante leçon de vie inspirée du récit d’immigration de sa famille.
-
![]() Fleurones2024 6 min
Fleurones2024 6 min -
![]() Ce qui brille dans le noir2024 1 h
Ce qui brille dans le noir2024 1 h -
![]() Texada2023 18 min
Texada2023 18 min -
![]() Second souffle2023 < 1 min
Second souffle2023 < 1 min -
![]() Mondes de glace (Omni)2022 35 min
Mondes de glace (Omni)2022 35 min -
![]() Traces : Expo 2020 Dubaï2022 1 h 15 min
Traces : Expo 2020 Dubaï2022 1 h 15 min -
![]() Liens de sang2022 18 min
Liens de sang2022 18 min -
![]() Similkameen : à la croisée des chemins2022 30 min
Similkameen : à la croisée des chemins2022 30 min -
![]() Vimy : mémorial vivant – Le pèlerinage numérique2022 15 min
Vimy : mémorial vivant – Le pèlerinage numérique2022 15 min -
![]() L'abeille et l'orchidée2022 5 min
L'abeille et l'orchidée2022 5 min